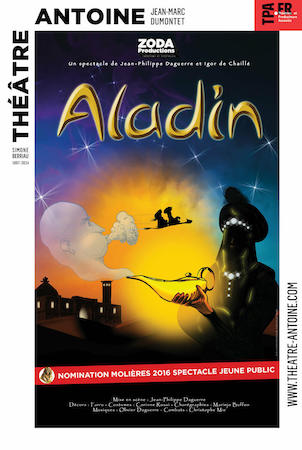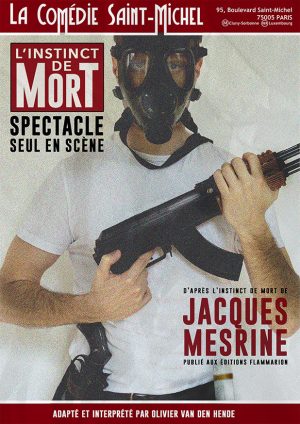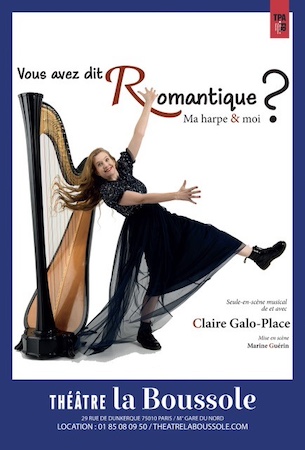Jane Planson : “Chaque nouvelle création est une avancée vers quelque chose d’invisible, d’inconnu, de délaissé, d’enfoui, d’ensommeillé”
À la découverte de Jane Planson, une artiste passionnée d’origine rouennaise qui nous donne l’occasion de découvrir son monde artistique à travers l’exploration de son mode de création, ses influences.
Comment est née votre vocation d’artiste ?
Mes parents peignaient tous les deux. C’était aussi naturel que respirer. Au lycée, mon prof de philo adorait Kandinsky et m’a convaincue de poursuivre un cursus artistique. À vingt ans j’étais prête à partir à New York pour faire une école d’art, j’avais passé mon permis en accéléré pour être jeune fille au pair et puis à la dernière minute, j’ai préféré gagner les bancs de la Fac d’arts plastiques de Rennes, pendant quatre ans. Je peignais déjà et ma première expo eut lieu à la galerie universitaire de Rennes II.

Nous avions réalisé avec des camarades des costumes et décors pour La Société des Timides à la Parade des Oiseaux, un groupe de rock dadaïste formé sur les cendres du groupe rennais Sarajevo. Je quitte Rennes et après un stage d’accessoiriste à l’opéra de Nantes, je rejoins mon compagnon à Rouen et me lie d’amitié avec le galeriste Daniel Duchoze. Nous visitons ensemble les ateliers de Ben Ami Koller, Richard Texier, Rhadamès Mejia… J’écris textes et éditos pour les artistes de la galerie.
Ma production de peintre n’existe pas encore suffisamment. Daniel, également cofondateur de la revue nationale Artension, m’intègre à la rédaction de la revue auprès de Pierre Souchaud alors directeur de rédaction. L’affaire dure quelques années puis je tombe malade. La revue dépose le bilan avant de renaître à Poitiers. Écrire sur la peinture, le théâtre, la danse ne me permet pas de vivre alors je passe une agrégation pour enseigner et faire de la recherche. Inscrite en philo et sociologie à Paris IV, je reprends parallèlement la peinture, je fais un enfant et je commence à exposer. Daniel Amourette sera mon premier galeriste. Je n’ai jamais arrêté depuis.
Quelles sont vos inspirations artistiques et vos influences ?
Les énumérer serait un peu long. Je pleure en découvrant les portraits profanes et atemporels du Fayoum, datant du premier siècle de notre ère, au Musée Archéologique de Naples. Au Quattrocento, chez Fra Angelico et Piero della Francesca, c’est la palette chromatique et la manière de construire l’espace narratif qui m’émeut. Au XVe siècle, la Vierge au Chanoine Van der Paele et la Vierge du Chancelier Rolin de Van Eyck me fascinent avec les espaces étrangement dissociés des figures et le réalisme des figures propre à la peinture flamande. J’aime encore quand les peintres prennent des libertés avec le sacré et substituent aux fonds d’or les premiers paysages.

Plus tard, la scandaleuse Mort de la Vierge du Caravage, le portrait du pape Innocent X de Velasquez, les peintures noires de Goya, les noirs et les blancs du Balcon de Manet m’accompagnent. Enfin, vers 1960, La Nouvelle École de Londres, Francis Bacon et Lucian Freud principalement, incarnent pour moi la grande tradition picturale figurative réaliste, décomplexée et obsessionnelle. Et c’est le moment où la figure vacille qui m’intéresse dans leur travail. Deleuze évoquait le figural à propos de Bacon et j’aime bien ce terme. Rebeyrolle, Richter, Kieffer, pour d’autres raisons me maintiennent dans une justesse et m’enseignent l’indifférence aux phénomènes de mode.
Expliquez-nous comment vous procédez pour la création d’une toile ?
Le processus de création est complexe et variable. La toile ou le papier sont des rings, des espaces de résistance et de bataille. Le sujet est souvent un prétexte qui permet d’aller à la rencontre de soi et des autres. On ne sait pas ce qui va se passer à l’avance. Chaque nouvelle création est une avancée vers quelque chose d’invisible, d’inconnu, de délaissé, d’enfoui, d’ensommeillé. Le cadre du châssis ou du papier permet de contenir ce qui pourrait exploser, se répandre ou s’anéantir. La toile est un monde avec lequel on converse ou on bataille, avec en filigrane l’envie de donner corps, de faire naître un état du corps, le sien et celui du modèle avec lequel on entretient par la force des choses une intimité. Car il y a toujours un modèle, un sujet incarné, même dans le paysage.

Chaque œuvre est en mouvement permanent même après un mois, un an, dix ans. Tout commence souvent par une figuration forte puis un processus d’effacement s’amorce avec la cire d’abeille que je fais chauffer sur la peinture fraîche. Mais après, quand il y a trop de dilution, cela m’intéresse moins : je perds la densité, la structure, la présence… Ne subsiste que du spectral, de l’informe. Jusqu’où aller ? Je reviens alors à la clarté du dessin par-dessus, puis j’efface encore… Et à un moment donné : statu quo. Je ne sais pas pourquoi cette alternance figure non/ figure prend fin. Ça passe par des renoncements, des refus. Il y a des toiles en stand-by, anciennes que je ne peux pas laisser comme ça. Je les reprends. Parfois ça ne va plus, tout est une affaire de correspondance. On reprend un bras, une ombre, on reprend tout ou bien on ne reprend rien. Je me donne cet objectif à chaque fois et quelque fois c’est déroutant, il vaudrait mieux tout recommencer mais subsiste un lien avec ce qui a été fait. Je ne peux dire « je dégage ça » Je ne jette pas ou rarement.

Il convient encore d’aller vite sur le sujet. Il faut y aller. La cire fait son entrée, je la chauffe, elle coule, efface, recouvre, éclabousse, enveloppe, opacifie puis devient translucide sous l’effet de la chaleur et se fige. Utiliser ce médium, c’est accepter que quelque chose puisse céder, disparaître, vous abandonner… Il faut que quelque chose d’étranger s’impose entre ce que j’ai peint et mon regard. Et cet intrus peut être la cire ; le passage de la cire serait comme un vecteur de vitalité, d’énergie. Il y a rarement quelque chose de caressant, c’est toujours incisif, il y a toujours un débat, une discussion forte, physique.

Quel message souhaitez-vous faire passer à travers vos œuvres ?
Si je le savais, je ne peindrais sans doute pas. Ce n’est pas à moi de trouver un message si message il y a, c’est à celui qui regarde qu’il appartient de décider. Peindre n’est pas seulement un choix, c’est une nécessité. Je peins avec ceux qui ne peignent pas. Je raconte pour que les non-peintres se retrouvent, se découvrent, partent à leur propre rencontre et acceptent de s’émouvoir. La peinture est un miroir et un révélateur d’état de nos corps.
Quel type d’art vous décrit le mieux ?
Je ne sais pas. Je ne comprends pas la question.
Quel est le moment le plus important dans votre carrière ?
Maintenant.

Pourquoi l’art ?
Ce n’est pas possible de “se farcir” le monde, il faut donc l’étriper, le mettre à plat pour le rendre supportable. Être un humain, ce n’est pas facile, être un existant pensant, c’est vraiment problématique. On est mal fait pour ça. On pense trop, ça me fatigue.

Peindre permet de suspendre le temps voire de l’arrêter et c’est salutaire quand on rencontre la maladie. À partir de vingt ans, j’ai constaté qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas dans le corps. Je me souviens très bien d’une période complètement hystérique où je me disais : “Je n’ai plus beaucoup de temps, je vais en profiter, il faut que j’en profite”, j’avais une vingtaine d’années ou une petite trentaine et un satané cancer comme sac à main.

J’arrive à la moitié de ma vie, je me dis : “Mince qu’est-ce que ça a été épuisant, je voudrais me reposer maintenant”. Et puis non, ce n’est pas possible. Le repos ou une forme de quiétude n’advient pas et parfois vous voulez juste faire cesser… ça vous rend puissant et exigeant la maladie. Il faudrait que chaque jour soit toujours éclatant, toujours solaire, toujours nouveau. Il y a cette quête effrénée de l’exceptionnel qui jaillit, malgré moi, mais qui rend malheureux. Alors la peinture permet de se poser et de se nourrir, d’aller chercher ailleurs encore, dans Les vagues de Virginia Woolf par exemple. Dans ce roman poétique, il y a une sorte d’extension du temps où elle va relater du présent, elle va le relater d’une certaine manière : se promener au milieu de la nuit, au petit matin dans un champ couvert de rosée. Ça a l’air tout simple mais elle le dit d’une certaine manière. Elle rentre, il fait chaud, elle va préparer le pain. Cette description du présent, cette communion avec les éléments du présent fait qu’elle peut rester en vie, et vous, elle vous permet d’être en vie, elle vous autorise à rester en vie. Il y a la musique aussi qui s’insinue dans les titres de mes toiles. L’art empêche l’anesthésie.
Quel est votre projet de rêve ?
Continuer de vivre et de peindre le plus longtemps possible.
Quelles couleurs dominent vos créations ? Et pourquoi ?

Pays cathare, août, 13h30
Les couleurs ne dominent pas vraiment, elles permettent d’affirmer le sujet ou de le recouvrir partiellement. Le fond de la toile de lin enduite de colle de peau est aussi couleur. J’ai beaucoup utilisé le blanc et le noir. Aujourd’hui c’est moins vrai car le bleu, un bleu Fra Angelico, prend le relais du blanc.
Comme je travaille sur une toile qui n’est pas blanche au départ, la question de la toile non recouverte signifie communément une forme d’inachèvement, mais c’est une habitude du regard. Pour moi, ce n’est pas de l’ordre de l’inachèvement. Pas du tout. La figure s’inscrit sur une surface qui est constituée d’une toile de lin enduite de colle de peau. Et cet environnement, qui est laissé sans peinture, porte la figure ; ça ne s’oppose pas, c’est l’espace de la figure, c’est son espace de respiration.

Couvent de la Tourette, variation, soir en février
Avec le blanc ou plus récemment le bleu, je recouvre pour calmer le jeu. C’est comme une forme d’absence. Là, je ne peux plus faire autrement. Je m’absente. C’était le cas pour la toile Adlene.A. La zone blanche devient une zone neutre pour la pensée, pour la projection possible et je n’ai pas envie de théoriser davantage cet usage du blanc ou du bleu qui relèvent de la sensation. Le blanc fait confusément référence au drap, au drap de lit, au drap d’hôpital, au drap qu’on va faire sécher, à la lumière, au lait. Il y a quelque chose dans le blanc qui est assez nourricier et protecteur. Ce n’est pas hostile le blanc, c’est quelque chose qui va être un peu réconfortant. Ça soulage, j’adore le blanc. Quand je mélange du pigment blanc de zinc avec de l’huile de lin, j’obtiens un blanc crème qui est pour moi le plus bel aliment visuel et j’ai envie d’en faire quelque chose, je m’en badigeonnerais le corps si je pouvais. Il y a quelque chose d’extrêmement sensuel, d’extrêmement jubilatoire avec le blanc, avec la pâte blanche. Ce peut être une chemise d’homme, ce peut être aussi quelque chose d’incertain. Il y a des toiles qui sont un peu énigmatiques, je crois. Par exemple, un blanc de parasol qui est devenu une histoire autour de Nietzsche et du récit du cheval qui avait été maltraité par son cocher (Le cheval de Turin). Cette toile s’est intitulée Nietzsche horse ; elle n’avait initialement rien à voir avec Nietzsche mais il y a eu ce blanc, ce blanc clinique, ce blanc de la maladie. Le blanc devient central. Le blanc couvre et révèle. Ça fait les deux.
Le blanc, c’est un peu comme le noir dense, doux, radical… Je me souviens de Chohreh Feyzdjou, une artiste iranienne qui présentait ses « products » contenant quelque chose de noir à la Galerie nationale du Jeu de Paume en 1994. Le blanc comme le noir ou le bleu me font revenir à un état premier. Effacement, révélation, effacement, révélation, effacement, dévoilement… Comme si je mettais fin à une vie et que je lui permettais de revenir. C’est une sorte de répétition jusqu’à ce que cela s’apaise. Cela ressemble à une lutte. D’autres avant moi ont procédé ainsi. Je songe à Giacometti ou à Bacon puisque c’est l’accident, dans cette question du figural, qui est en jeu. L’accident est comme un pas de côté nécessaire.
Vos futurs projets ?
J’aimerais re-présenter le concours de portrait de la BP Award à Londres quand la National Gallery pourra de nouveau accueillir les candidats. J’aime bien l’émulation internationale de ce concours. Une amie m’a proposé une exposition à Porto où j’ai déjà présenté mon travail il y a 10 ans. La Galerie Duchoze-Rethoré à Rouen, la Galerie franco-coréenne TRES à Nantes et Le Rayon Vert à Nantes me représentent en permanence. Le dernier week-end de mai et le premier de juin, je participe à une exposition organisée par mon premier galeriste. Le lieu, une église offre une lumière fabuleuse et la Normandie est merveilleuse au printemps. Demandez à David Hockney ce qu’il en pense !
Propos recueillis par Jade Schreiner
Articles liés

“Riding on a cloud” un récit émouvant à La Commune
A dix-sept ans, Yasser, le frère de Rabih Mroué, subit une blessure qui le contraint à réapprendre à parler. C’est lui qui nous fait face sur scène. Ce questionnement de la représentation et des limites entre fiction et documentaire...

“Des maquereaux pour la sirène” au théâtre La Croisée des Chemins
Victor l’a quittée. Ils vivaient une histoire d’amour fusionnelle depuis deux ans. Ce n’était pas toujours très beau, c’était parfois violent, mais elle était sûre d’une chose, il ne la quitterait jamais. Elle transformait chaque nouvelle marque qu’il infligeait...

La Croisée des Chemins dévoile le spectacle musical “Et les femmes poètes ?”
Raconter la vie d’une femme dans sa poésie propre, de l’enfance à l’âge adulte. En découvrir la trame, en dérouler le fil. Les mains féminines ont beaucoup tissé, brodé, cousu mais elles ont aussi écrit ! Alors, place à leurs...